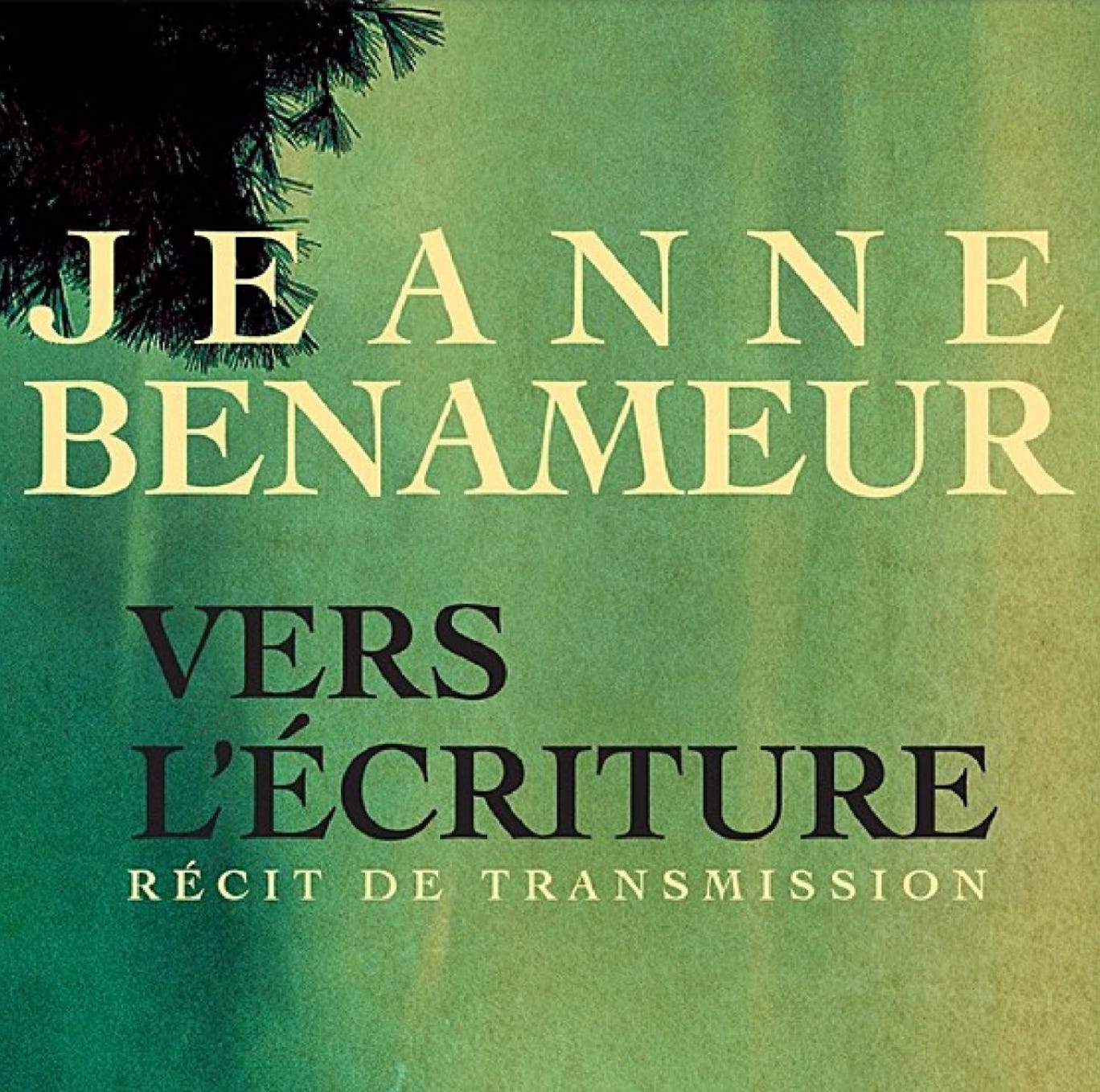Une leçon d'écriture
S'autoriser à écrire, c'est apprendre à se donner le temps de regarder son texte comme s'il était celui de quelqu'un d'autre
Je lis Vers l’écriture (Actes Sud) un livre de Jeanne Benameur qui parle techniquement et intelligemment de l'écriture, du rapport que nous avons à l'écriture, et des ateliers d'écriture qu'elle anime, et des exercices qu'elle y propose (en ce sens son livre est aussi un manuel pour quiconque anime ce genre d’ateliers).
À l’heure où de moins en moins de gens se passent d’un IA pour écrire (ce qui donne souvent des textes sans caractère, des textes statistiquement moyens, qui ne dérangent ni n’apportent rien à personne, tout en accélérant l’écocide), son récit de transmission nous rappelle à quel point écrire est le mouvement même de la pensée. Il y a une dimension politique à mettre de l’écriture dans sa vie, à en faire une activité quotidienne, d’élaboration personnelle, de réflexion, d’expression — et peut-être qu’un tel espace est encore plus précieux quand le bruit recouvre le silence, et que le monde prend de drôles de couleurs.
Jeanne Benameur distingue le scripteur de l'auteur. C'est une distinction intéressante et qui me parle. Être scripteur, c'est écrire sans se juger, sans juger ni évaluer ce qu'on écrit au moment où ça s'écrit. C'est se laisser emmener par l'écriture là où elle nous mène et nous emmène, même et surtout si ça n'est pas l'endroit qu'on avait imaginé au départ (on parle ici d'une écriture d'inspiration, d'écrire pour soi, un journal par exemple, ou pour les autres, écrire une histoire, un roman, etc, ce qui passe par la tête, l’écriture comme un art que l'on pratiquerait au même titre que la peinture, ou la sculpture, ou le dessin, ou la photographie, etc).
Pouvoir se laisser aller à écrire ce qui nous vient n'est pas une chose facile. Jeanne Benameur remarque que dans ses ateliers, beaucoup de gens, devant un texte qu'ils viennent de produire, le jugent immédiatement, ils disent c'est nul", ou au contraire ils pensent que c'est intouchable, rien à bouger, rien à changer. C'est aller trop vite, sauter les étapes.
“Il faut renoncer à être celui qui lit par-dessus sa propre épaule, censure son propre texte alors qu’il est en train de s’écrire. Je crois qu’il n’y a pas pire censeur que soi-même. Et ça part d’un désir qu’on peut penser légitime. On veut que ce soit “mieux” tout de suite sans se rendre compte que par là même on nie déjà ce qui est en train de s’écrire.”
Ce qui est important d'après son expérience, et l'observation de ses stagiaires, ses écrivants, c'est ne surtout pas aller trop vite, ne pas vouloir tout de suite sauter à la case auteur (l'auteur, dit-elle, c'est celui où celle que nous sommes quand nous pouvons signer notre texte, c'est-à-dire l'assumer devant les autres, assumer de le faire lire et d'en avoir des retours, en prendre la responsabilité, donc c'est le moment où le texte devient public, et nous échappe, qu'on le lâche).
Il faut au contraire, dit-elle, prendre le temps de découvrir ce texte qu'on a écrit, donc le relire, l'observer, voir ce qu'il est, et qui n'est jamais ce que l'on voulait écrire, ce que l'on a voulu écrire, parce que le langage tombe toujours d'une certaine manière à côté (et je n'aurai pas besoin ici de convoquer Lacan ou Saussure pour affirmer que l'expression échoue toujours).
L'écriture, par sa pulsation, sa physiologie propre, le mouvement de la main qui tient le stylo ou frappe le clavier, entraîne toujours ailleurs - du moins si on a su, dans ce premier jet, lâcher la bride au scripteur. Si on a su faire taire en soi le juge, le censeur, le terrible censeur ! Il n'y a pas pire frein que l'auto-censure pour quelqu'un qui écrit, et j'en sais quelque chose, mon censeur est un type impitoyable, un véritable sadique quand il est mal luné.
Jeanne Benameur insiste sur l'importance de ce travail que j'appellerais de maturation ou décantation. Après avoir écrit quelque chose, laisser reposer, se donner le temps de le regarder à nouveau, de l'appréhender, de le fréquenter. Sage conseil. Il s’agit de découvrir ce qu’on a écrit.
Le scripteur est emmené par son mouvement, par les mots qui se bousculent et qu'il pose sur la page un peu comme ils viennent, et on ne peut pas à la fois laisser ce mouvement se faire, vers l'inconnu en soi (là où peut-être on redoute d'aller) et, déjà, prétendre se placer en surplomb des phrases qu'on aligne, prétendre juger déjà de leur pertinence, de leur équilibre, de leur justesse, etc. Ce serait couper son propre élan, museler la voix intérieure qui fraie son chemin par l'écriture.
Donc, dit-elle, pour ne pas brûler les étapes, pour conserver son texte vivant, il faut entrer dans son intimité, voir ce qu'on a écrit, ce que c'est, et à cet effet elle pose des questions aux stagiaires de ses ateliers d'écriture, pour les aider à regarder leurs écrits sous différents angles. Qu'ils prennent par exemple le temps d'un examen de l'écriture elle-même (plutôt que du sens, du contenu du texte). Examiner la forme, la ponctuation, les particularités du choix des mots, et à qui on s'adresse, dans quel registre de langue, et qui parle, et d'où, etc : et en observant le texte à partir de ces questions, apprendre à le connaître et le reconnaître, apprendre à le lire comme le texte de quelqu'un d'autre (plutôt que chercher en quoi il ne serait pas conforme à l'idée qu'on s'en était formé, à l'ambition qu'on avait, aux préjugés qu'on a sur ce qu'il est souhaitable ou permis d'écrire, etc). Commencer donc à le voir autrement, avec une heureuse distance : c'est-à-dire comme un lecteur exigeant et bienveillant. On pourrait avoir des surprises.
Et vous, écrivez-vous ? Qu’écrivez-vous ? Que voudriez-vous écrire ?